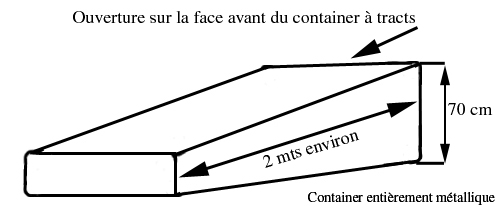|
EVASION par F/O (Officier de l’Armée
de l’Air) Alfred J HOUSTON
Raconté à Geoffrey HEWELCKE
Les ténèbres m’entouraient, et dans
l’angle du grand talus breton, directement
derrière moi, l’obscurité de la nuit
était encore plus profonde. Le ciel au-dessus
était couvert. En-dessous, je pouvais toucher de la
main des terres fraîchement labourées.
L’odeur des terres me semblait aussi bien que
n’importe quel champ fraîchement labouré
à Ontario. Je remuais mes doigts de pied dans mes
bottes d’aviateur mouillées, et je continuais
à attendre.
Bientôt, j’ai entendu quelqu’un
siffler au loin – un petit air de jigue. De plus
près quelqu’un d’autre a repris la
mélodie. Puis les deux siffleurs se sont
arrêtés.
Tout d’un coup je me suis trouvé
entouré d’hommes. Il me semblait qu’ils
étaient sortis de la terre même. Ils
étaient nombreux.
Près de mon épaule, j’ai entendu
dire, ‘Nous sommes des Patriotes. Nous luttons pour la
France. Nous sommes les hommes de DE GAULLE’.
J’ai serré la main à la personne,
qui m’a adressé. C’était leur
capitaine. Je vais l’appeler Tony, même si ce
n’est pas son vrai nom. Je dois vous dire dès
maintenant que tous les noms que j’utilise dans ce
récit, ne sont pas les vrais noms, au cas où
les allemands gardent certains de leurs familles comme
prisonniers. Les allemands peuvent se venger sur ces
incarcérés…..ça je le sais.
Tony a touché de ses doigts mon uniforme de
bataille RCAF, et il a fait signe de la tête.
‘Ça ne va pas’, a-t-il dit. Il a
parlé brusquement en français, juste quelques
mots, et un paquet de vêtements m’est parvenu de
quelque part derrière nous. A la touche, j’ai
découvert un pantalon civil, un gilet, et des
souliers cloutés, que plus tard j’ai reconnu
comme de l’uniforme allemand. J’ai changé
de vêtements là où j’étais,
dans la nuit noire.
Puis quelqu’un m’a passé un
pistolet-mitrailleur Sten. ‘Chargé ?’
Ai-je demandé. ‘Chargé,’ a
été la réponse….. Je faisais
partie maintenant du groupe de Patriotes de Tony – du
groupe que plus tard les journalistes appelleraient le
‘Maquis’, mais je n’entendais jamais ces
hommes utiliser ce nom eux-mêmes.
Plus tard la même nuit, Tony et mes nouveaux
camarades m’ont emmené dans une grange où
on a pu allumer une bougie en sécurité.
C’était le moment où je les ai vus. Il y
en avait à peu près une trentaine – des
hommes d’aspect dur et hâlé, la plupart
entre les âges de 18 et 30 ans. Tous, ils sont
‘allés dans les champs’, plutôt que
de partir en travaux forcés pour les allemands. Tous
étaient armés - ou avec des pistolets
mitrailleurs Sten et grenades, parachutés par nos
avions – ou avec des fusils et pistolets allemands. Si
un Patriote avait un fusil allemand en main, j’ai vite
compris qu’un soldat allemand se décomposait
dans une tombe peu profonde quelque part au milieu d’un
champ breton.
Dans la grange, j’ai expliqué à
Tony et aux autres, que j’étais navigateur
d’un RCAF Wellington et que notre mission avait
été de parachuter des brochures au-dessus
d’une ville pour avertir les habitants
d’éviter les routes au moment du commencement de
l’invasion ; et que c’était en
retournant que nous avions rencontré un Junkers 88 et
que notre réservoir à gaz avait
été percé par un obus allemand. Je lui
ai dit qu’il y avait cinq autres membres de
l’équipage quelque part dans un rayon de 20
miles.
Tony a pris note de leurs noms et de leurs
signalements. Il s’agissait de Flying Officer Harold
BRENNAN, pilote. Il venait de Lindsay, Ontario.
Moi-même, je viens de Toronto. Avant la guerre
j’étais représentant de produits
chimiques pour la société A. S. BOYLE. Il y
avait les sergents Andy ELDER, canonnier arrière
(rear gunner), qui était de Vancouver, British
Columbia ; Ernie TROTTER, de Cornwall,
bombardier ; Roger DICKSON, de Vernon, British
Columbia, canonnier de dessus au milieu (mid upper gunner),
et Johnny KEMPSON, radiotélégraphiste, de
Surbiton en Surrey – le seul anglais parmi notre
équipe de canadiens.
La date était le 20 avril, au printemps de
l’année dernière. J’ai
expliqué à Tony que j’avais
conseillé aux gars de si diriger dans la direction
sud-est vers la frontière espagnole, quand nous
avions sauté de l’avion ; et il a pris note
de ça aussi.
Quelques minutes plus tard, j’ai entendu la
sonnette d’une bicyclette dehors, et Tony a
éteint la bougie, pour pouvoir ouvrir la porte. Puis
il l’a rallumée. Une fillette a poussé
ses tresses derrière ses épaules, et
s’est tenue debout, droit devant lui. Elle était
une des messagères qui faisaient partie du
système des Patriotes – et elle était
fière de son rôle.
Elle a parlé rapidement avec lui, dans une
langue que je n’ai pas reconnue. Très
sérieux, il a fait signe de la tête, elle a
continué à parler. Bien entendu, elle parlait
breton – une langue qui ressemble au gallois – et
dont je ne comprenais pas un mot.
‘On a trouvé un de vos amis, gravement
blessé.’ Tony s’est retourné vers
moi, ‘Un jeune, aux cheveux noirs, et au visage
long.’
J’ai réfléchi un instant.
‘C’est sûrement Johnny Kempson’,
j’ai suggéré, ‘Qu’est-ce qui
lui est arrivé ?’
‘Un médecin est avec lui, à 20
miles d’ici,’ m’a dit Tony, ‘On l’a
trouvé inconscient parmi des rochers dans des landes.
Vous voulez le voir ?’
‘Bien sûr,’ ai-je dit.
Tony a parlé à quelqu’un
derrière nous. Encore une fois, la bougie a
été éteinte, et la porte de la grange a
ouvert. Encore une fois on a rallumé la bougie.
‘J’ai dit à un des gars de voler une
voiture’, Tony m’a dit, ‘Il sera
bientôt de retour.’
Il m’a regardé d’une manière
curieuse, presque avec envie.
‘Ça doit être magnifique de pouvoir
voler dans ces avions,’ m’a-t-il dit, ‘De
pouvoir tirer sur les allemands – de pouvoir les
bombarder. Nous qui sommes obligés d’avancer
à quatre pattes dans les champs et dans les
fossés, on donnerait notre jambe droite pour pouvoir
faire comme vous.’
‘Vous aussi, vous avez un travail à
faire,’ je lui ai suggéré.
Tony a fait signe de la tête. ‘C’est
vrai,’ a-t-il admis, ‘Et on le fait. Ne croyez pas
qu’on n’est pas soldat parce qu’on n’a
pas d’uniforme. On a tué un grand nombre
d’allemand, et on en tuera encore.’
La férocité de sa voix m’a
surprise. Mais maintenant, non. Je sais maintenant ce que
font les allemands aux Patriotes quand ils les prennent.
Pourtant, le moment après, Tony m’a
demandé si tout s’était bien passé
quand j’avais parachuté de l’avion. Je lui
ai dit que j’avais atterri dans un champ, tout en
chantant à pleine voix, tellement j’étais
heureux d’être encore vivant. Il a souri quand je
lui ai expliqué que mon parachute n’avait pas
ouvert immédiatement. Il a souri d’un air
approbateur quand je lui ai raconté comment je
m’étais sauvé à travers les champs
et les talus, à travers une rivière, et puis
que j’avais rebroussé chemin pour essayer de
confondre les chiens que j’avais entendu aboyer au
lointain, des chiens qui auraient pu montrer ma piste aux
allemands. Je lui ai raconté également tout
mon parcours de ce jour avant de rencontrer finalement
l’homme qui m’avait emmené au champ
où je leur avais rencontré.
Très peu de temps après, une voiture est
arrivé devant la grange. Cinq des Patriotes, et
moi-même sommes montés dedans. Les allemands
avaient interdit à la population d’être
dehors après 9 heures du soir. Mais cela ne changeait
rien aux Patriotes.
Plus tard, je me suis trouvé à
côté de Johnny. Il avait le visage gris. Un
médecin et une femme s’occupaient de lui.
‘Johnny,’ ai-je crié.
Il a tourné la tête un petit peu, mais
c’était évident qu’il ne me voyait
pas. Je me suis mis à genoux à
côté de son lit. Il a mis ses bras autour de
moi.
‘Je veux retourner chez moi,’ m’a-t-il
murmuré. Le médecin, un homme aux cheveux
gris, et avec un visage gentil et aimable, a secoué
la tête. Je lui ai pris à part et il m’a
expliqué la mauvaise nouvelle. Les Patriotes avaient
trouvé Johnny parmi les rochers. Peut-être que
son parachute l’avait tiré par là. En
tout cas, il avait une fracture crânienne, et des
blessures internes aussi.
‘On ne pourrait pas trouver un moyen de le faire
passer dans un hôpital militaire allemand,’ ai-je
demandé, ‘Là, il aura une
chance.’
Le médecin a souri tristement. ‘Pas
maintenant,’ a-t-il dit, ‘Je lui ai
déjà soigné, et les allemands le
sauront – je serais fusillé, parce que dans leur
règles, ils disent qu’un parachutiste
blessé doit être laissé là
où il est tombé.’
Les patrouilles allemandes venaient souvent à
ce village, et Tony a pris la décision d’emmener
Johnny Kempson dans un autre lieu. Nous l’avons mis
dans la voiture et nous l’avons conduit
jusqu’à un autre village à une distance
d’environ 15 miles de là. On l’a mis dans
une grange sur la paille. Je suis resté avec lui,
ainsi que 2 des Patriotes.
Ils ont creusé une tombe
Au cours des prochains 5 jours, tout le reste de
l’équipe de Wimpy ont été
trouvé par les Patriotes, qui nous les emmenaient un
par un.
Pendant cette période, le médecin a
rendu visite à Johnny tous les jours, et a fait venir
un spécialiste d’une ville voisine, un
spécialiste en trauma crânien.
Malgré nos soins, et malgré les visites
journalières des 2 médecins, Johnny est
décédé le matin du sixième jour.
On savait qu’il allait nous quitter, et avant sa mort,
les Patriotes ont fait venir un curé, même si
Johnny n’était pas catholique.
Cette nuit-là, l’équipe de Wimpy
s’est rassemblé dans le village. Ils (les
habitants du village ?) avaient passé la
journée à creuser une tombe pour Johnny sur
une colline à environ 15 miles d’où on
était. Ils avaient creusé pendant 9 heures
pour faire la tombe, tellement la terre était
rocailleuse.
Tôt le lendemain, nous avons enterré
Johnny. Notre équipe a formé une haie
d’honneur ; un curé du village le plus
proche a célébré la messe, et un groupe
de Patriotes déguenillés, penchés sur
leurs fusils, ont assisté, mais un peu à
l’écart.
Six semaines plus tard, j’y suis repassé,
et j’ai vu que les enfants du village avaient mis des
fleurs sur cette tombe de cette personne qui leur
était inconnue.
Après l’enterrement, Tony nous a
rassemblés un peu à part.
‘Maintenant, on est prêt’ a-t-il
dit.
‘Prêt à quoi ?’ Ai-je
demandé.
‘Vous voulez regagner la frontière
espagnole ?’ A-t-il dit. ‘Cela fait partie de
notre devoir en tant que Patriotes, d’aider les
aviateurs des Alliés à s’évader
des allemands…. Vous êtes des combattants
d’une grande valeur…. Cela a coûté
beaucoup de temps et d’argent pour vous former pour vos
tâches…. Eh bien, 18 hommes de notre groupe vous
conduiront dans la direction du sud-est, jusqu’aux
limites de notre territoire. On sera guides et gardiens pour
vous. On vous emmènera et on combattra pour vous. Et
on ne vous demande qu’une seule chose – de ne pas
risquer vos vies en combattant, sans la
nécessité de le faire…… Laissez le
combat à nous.’
Nous sommes partis, direction sud-est.
L’attaque de la Gestapo
Traverser le pays avec les Patriotes était sans
problème – au début. Plus tard, quand la
Gestapo nous suivait de plus en plus près, cela est
devenu un cauchemar. Derrière nous, nous avons
laissé une traînée de sang et de
souffrance. Au début, pourtant, les Patriotes
connaissaient les routes où il y avait peu de risques
de tomber sur des patrouilles. Ils connaissaient quels
fermiers nous donneraient à manger sans poser de
questions….. Quelles forêts étaient les
plus sûrs.
En plus leur ‘service d’information’
était tellement bien organisé. Des filles
à bicyclette, de jeunes fermiers, des fils de
fermiers, passaient de temps à autre. La nuit, on
entendait quelqu’un siffler une mélodie dans les
ténèbres…. Un des nôtres sifflerait
une autre mélodie. Il y aurait une réponse
sifflée et une forme obscure sortirait des ombres
pour nous murmurer quelques mots d’information.
Mais les allemands ont frappé rapidement. La
deuxième nuit, à environ 40 miles de
l’endroit où nous avons enterré Johnny,
j’ai été réveillé par des
voix tout près de moi. Je leur ai
écouté, et je me suis mis debout. Une des voix
appartenait à un jeune d’environ 17 ans, qui
nous avait aidés à soigner Johnny Kempson. Il
n’était pas venu avec nous, mais maintenant il a
réussi à nous retrouver, et il avait une
histoire affreuse à nous raconter. D’une
manière ou d’une autre, les allemands ont appris
l’histoire de Johnny. Ils ont été
informés du rôle du médecin. Ils
l’ont torturé. Ils ont cassé ses deux
poignets, ils les ont tordus…. Puis ils l’ont
tué.
La voix du jeune homme était dur et sans
émotion. Il a aussi raconté que lui-même
avait été capturé mais qu’il a pu
se sauver.
C’était le premier français,
à donner sa vie pour nous ; ce médecin
doux et gentil qui savait bien qu’il risquait sa vie
pour soigner Johnny ; mais qui venait quand même
tous les jours. Je n’ai jamais connu son nom.
Tony nous a réunis immédiatement. Il
nous a dit que c’était évident que les
allemands avaient des informations sur nous, puisque ils en
avaient sur Johnny. Ça voulait dire que la Gestapo
devant nous serait avertie, et que derrière nous, la
Gestapo suivait déjà nos traces. Il fallait
continuer avec beaucoup de prudence.
On s’est mis en route toute de suite. Le jeune,
qui nous avait donné les affreuses informations,
devait rejoindre un autre groupe de Patriotes.
Peut-être c’est maintenant le moment de
vous parler de nos guides. Il y avait bien sûr Tony,
grand, bronzé, extrêmement efficace en tant que
chef et capitaine élu de la bande. Il avait
vécu ‘dans les champs’ depuis la reddition
de la France.
Un des autres était coiffeur et il nous coupait
les cheveux. Deux d’entre eux, étaient
marins.
Parmi les autres il y avait des employés de
bureau, des ouvriers, et des fermiers et des ouvriers
agricoles. Agés tous d’entre 18 et 30 ans ;
physiquement en forme et donc recherchés par les
allemands pour les travaux forcés. Tous sans
exception avait une forte détermination de lutter
contre les allemands jusqu’au dernier souffle. Ils se
considéraient comme soldats pour la France.
Un groupe de Patriotes n’était jamais trop
nombreux – environ 15 ou 20 hommes ou femmes au plus,
qui collaboraient avec eux, mais qui pour la plupart ne
vivaient pas ‘dans les champs’. Chaque groupe
avait un capitaine élu. Chaque capitaine
répondait à un officier supérieur.
Chaque officier supérieur avait 5 groupes sous son
contrôle. Chaque officier supérieur
répondait à un pouvoir au-dessus de lui, qui
était en contact avec l’état-major du
Général DE GAULLE, d’où il
recevait ses ordres, et à qui il transmettait leurs
demandes d’armes et de dynamite.
La flexibilité de l’organisation
était vraiment incroyable et en même temps le
système de commande fonctionnait parfaitement.
Coup de feu du couvre-feu
Nous avons continué sur notre chemin, et nous
avons trouvé de quoi manger dans la nature, autant
que possible, en faisant la chasse aux lapins dans les bois,
et en prenant des poissons dans les rivières. A
l’occasion, nous avons pu acheter du pain dans des
fermes isolées.
Bientôt nous avons reçu un nouveau
message, pour nous avertir que la Gestapo était sur
notre piste. Nous nous sommes divisés en petits
groupes de 2 ou 3. Pendant environ 4 jours, mes deux guides
se sont occupés de moi, et par la suite nous avons pu
rejoindre les autres dans une petite ville beaucoup plus au
sud.
Ce vendredi, au soir, un médecin de la ville
est venu nous voir. Il a invité nous les canadiens
à lui rendre visite pour le weekend.
‘Vous pouvez manger de la bonne cuisine faite
maison’, a-t-il dit en souriant, ‘En plus, je
pense que vous voudriez bien prendre un bain et dormir entre
des draps.’
Nous étions incertains. ‘Cela ne vous
entraîne pas trop de risques ?’ Nous lui
avons demandé. ‘Je pense savoir m’occuper
de mes affaires,’ a-t-il répondu en
souriant.
Samedi, à midi, nous avons quitté notre
camp deux par deux. Un membre de l’équipage avec
un guide des Patriotes.
Après notre weekend de repos à la maison
du docteur, nous sommes repartis juste avant l’heure du
couvre-feu, imposé par les allemands, à 9
heures du soir, et nous nous sommes dirigés vers les
limites de la ville. Tout d’un coup
l’éclaireur Patriote, un peu à
l’avance de nous, a levé la main pour nous
avertir. A l’instant, nos guides nous ont
poussés vers l’entrée d’une petite
ruelle.
‘Il y a une patrouille allemand qui
s’approche de nous…..’ Ont-ils
chuchoté.
Dans une maison près de nous, une porte
s’est ouverte, et une fillette de 5 ou 6 ans, en est
sortie en vitesse. Elle avait rendu visite à une
copine, et était restée trop longtemps. Elle
était arrivée au milieu de la rue, quand nous
avons entendu la claque sèche d’un fusil. La
fillette s’est retournée vivement ; et puis
elle est tombée….Elle a donné deux
petites secousses avec ses pieds…..Et puis elle
n’a plus bougé.
Nous, aviateurs, étaient stupéfaits et
horrifiés par la violence brutale de l’acte. La
nausée nous a pris. Puis nous avons saisi nos Stens,
et nous étions sur le point de sortir en courant de
la ruelle, quand les Patriotes nous ont retenus.
‘Mauvaise idée,’ nous ont-ils dit,
‘Pas bon. Si vous tuez la patrouille – les boches
vont prendre leur revanche en tuant 30 ou 40 habitants de
cette ville’.
Avec beaucoup de précaution, ils ont
regardé autour, et ils ont surveillé la rue.
Au carrefour, nous avons pu voir, à peine et avec
difficulté, quatre allemands, portant à la
tête des casques en acier. Ils étaient
penchés sur leurs bicyclettes. Un d’entre eux,
sur ses gardes, tenait son fusil et regardait en même
temps le petit corps pitoyable près de nous. Mais il
n’a pas osé l’approcher. Un petit peu de
temps plus tard, les allemands sont montés sur leurs
bicyclettes et sont partis.
‘Ça c’est la France comme elle
est aujourd’hui,’ mon guide a chuchoté.
‘Regardez, il y a une fenêtre d’ouverte pour
voir pourquoi il y a eu cette fusillade.’
‘C’est l’enfer,’ ai-je dit.
‘Cela ne va pas durer longtemps – je vous le
jure, cela ne va pas durer,’ m-a-t-il répondu
avec émotion.
Notre route
barrée
Deux jours plus tard et nous étions à la
limite du territoire connu par Tony et son groupe. Un autre
groupe de Patriotes nous a rencontrés et
c’était maintenant à eux de nous
accompagner plus loin. Le groupe consistait de 13 hommes
sous la commande d’un capitaine que j’appellerai
‘Jean’. C’était un ancien capitaine de
L’Armée qui vivait maintenant ‘dans les
champs’.
Pendant deux jours, nous avons continué notre
voyage avec lui, et puis un messager est arrivé pour
l’informer, que les allemands ont appris que beaucoup
d’aviateurs alliés arrivaient à
s’évader en passant par l’Espagne.
D’entiers régiments de la Gestapo avaient
été mobilisés pour patrouiller la
frontière. Cela ne servait à rien de
continuer.
Alors nous avons fait demi-tour, et repris le chemin
vers le nord et vers la Bretagne ; pourtant nous
n’avons pas pris la même route que la
première fois.
Une semaine plus tard nous avons aperçu une
patrouille allemande, d’une vingtaine de soldats. Ils
nous ont vus aussi. Immédiatement ils nous ont
poursuivis à travers les champs. Ils allaient nous
rattraper et en plus ils possédaient des fusils
d’une portée plus longue que nos mitraillettes.
Les balles arrivaient de plus en plus près.
Bientôt on serait obligé de les
combattre, et ils étaient plus nombreux et mieux
armés. A quatre pattes, nous avons traversé un
talus boisé, ce qui nous servait d’obstacle,
quand un des Patriotes – un jeune de 28 ans, costaud,
bronzé, s’est approché subitement du
capitaine Jean, et l’a salué.
‘Je demande permission de rester ici pour
combattre l’ennemi,’ a-t-il dit. ‘Avec mon
Sten et peut-être un autre aussi, j’arriverai
à les retenir pour une demi-heure, pour vous donner
le temps d’échapper.’
Le capitaine Jean l’a regardé de
près. Puis il a salué. ‘Permission
accordée,’ a-t-il dit.
Le jeune homme a pris un autre Sten et s’est
installé dans le fossé, ses armes
dirigées à travers le talus en direction du
champ de l’autre côté. Il s’est mis
à tirer toute de suite.
‘Venez vite,’ le capitaine Jean nous a
donné l’ordre. ‘Que son sacrifice ne soit
pas pour rien.’
Nous avons continué en courant. Derrière
nous, nous avons pu entendre le bruit des fusils, et puis du
silence. Un peu plus tard, nous avons entendu des cris
aigus, un bruit affreux et angoissant. Plus tard nous avons
appris qu’il avait été blessé,
capturé, et puis rapidement torturé à
mort.
Quelques jours plus tard, nous étions en train
de traverser un champ, quand des balles ont claqué
dans l’air autour de nous, suivies quelques secondes
après par le bruit sec d’une détonation.
Nous sommes tombés par terre – mais un des
Patriotes est resté sans bouger.
‘Il est mort,’ a dit le capitaine Jean.
‘Léo, Paul, Jacques et André –
c’est votre devoir de prendre nos aviateurs au bois
près du ruisseau, que vous connaissez. Vous autres,
restez ici avec moi, et on va repousser les
allemands.’
A quatre pattes, nous avons réussi à
atteindre un fossé, et nous nous sommes
dirigés à plat ventre vers un passage dans un
talus. Derrière nous, des fusils claquaient.
Cette nuit, le capitaine et deux des autres nous ont
retrouvés. Les trois autres étaient
restés dans le champ, tués par les allemands.
A leur avis, ils avaient réussi à tuer au
moins deux de l’ennemi, et les allemands ont finalement
pris la décision de se retirer.
Nous avons continué notre chemin vers le nord
pour une distance d’à peu près 80 miles,
jusqu’à un vieux moulin. Ici on nous a dit que
nous serions obligés d’attendre quelque temps,
pour donner aux Patriotes la possibilité
d’organiser une autre solution pour notre
départ. En attendant, nous devions vivre dans une
petite pièce, au grenier du moulin ; nous
devions prendre soin de ne pas faire du bruit parce que les
allemands venaient régulièrement prendre leurs
repas dans la salle, deux étages en-dessous de nous.
Nous avions le droit de fumer seulement quand personne
d’autre n’y était. La nuit, nous devions
prendre soin de ne pas faire apparaître de la
lumière, et nous ne devions pas nous approcher de la
seule fenêtre, couverte comme elle était de
toiles d'araignée. La femme du meunier, une dame
très aimable, ainsi que sa fille, nous apportaient de
quoi manger.
Un séisme de fusils
Nous sommes restés dans cette pièce
pendant six semaines ; six semaines qui étaient
parmi les plus monotones et ennuyeux de ma vie.
Dans la pièce il y avait deux lits. Nous
étions cinq, ce qui voulait dire que chaque nuit un
de nous dormait au sol, sur le plancher. On avait un jeu de
cartes, une table avec cinq chaises, un sceau de toilette.
Rien de plus.
On jouait au bridge, et ça sans cesse. Vivre si
près des autres, cet existence si monotone, devoir
chuchoter pour parler ; petit à petit les autres
vous énervaient, et nous avons fini par se
détester.
C’était pendant ce temps que nous avons
appris que le médecin qui nous avait accueilli pour
ce beau weekend, a été obligé avec sa
femme d’aller vivre ‘dans les champs’, parce
que les allemands ont réussi à
découvrir ce qui s’était passé.
De temps à autre les Patriotes passaient nous
rendre visite, avec des cigarettes et du tabac de pipe
volé dans un entrepôt du coin. La ration de
cigarettes pour les civiles était de 20 cigarettes
par mois : chacun de nous fumait plus que ça par
jour.
Au moulin, on avait le temps de
réfléchir, et de s’inquiéter pour
nos familles – et de penser à
l’inquiétude dont nous étions la cause.
Nous étions bien sûr portés disparus, et
ils ne savaient pas si nous étions toujours en
vie.
Par moments, nous avons même discuté de
notre situation, et s’il valait vraiment l’effort
de continuer à essayer de nous évader ;
peut-être que ce serait mieux de nous livrer aux
allemands. Mais à chaque occasion que cette
idée nous venait à l’esprit, on se
souvenait de tous ceux qui avaient donné leur vie,
sans nous le reprocher, et volontiers – parce
qu’ils pensaient sauver la vie à des combattants
formés et expérimentés :
impossible pour nous de baisser les bras.
C’était le 6 juin – le Jour J –
pendant la cinquième semaine de notre séjour
au grenier de ce moulin. C’était à moi de
dormir au sol, et je me suis réveillé en
pensant qu’il y a eu un tremblement de
terre ,
qui a secoué le bâtiment. Je suis resté
allongé sur les planches en bois et j’ai encore
ressenti des tremblements de terre. J’ai bien
écouté, et j’ai entendu des canons au
loin. Immédiatement j’ai réveillé
mes camarades, et nous sommes restés dans le noir,
les oreilles tendues. ,
qui a secoué le bâtiment. Je suis resté
allongé sur les planches en bois et j’ai encore
ressenti des tremblements de terre. J’ai bien
écouté, et j’ai entendu des canons au
loin. Immédiatement j’ai réveillé
mes camarades, et nous sommes restés dans le noir,
les oreilles tendues.
Nous avons bien deviné et compris ce qui se
passait. A notre avis il y avait trop de bruit pour que ce
soit du tir de DCA (contre les avions). Ce qu’on
entendait c’était des canons navals – en
tout probabilité des obus préliminaires avant
l’Assaut.
A 9 heures du matin, le neveu du meunier est
entré dans la pièce en courant, deux
bouteilles de vin en main, les larmes aux yeux.
‘Les anglais ont débarqué,’
a-t-il crié. Derrière lui un cliquetis sur
l’escalier. Le meunier, sa femme et leur fille
montaient l’escalier. Nous avons ouvert le vin, et nous
avons bu en silence à cette glorieuse matinée,
et par la fenêtre nous avons regardé les
groupes de travailleurs forcés, poussés par
les allemands, en train d’enfoncer des poteaux en bois
dans la terre, pour empêcher aux planeurs des forces
de l’invasion d’atterrir.
Cette même nuit, et les nouvelles étaient
encore une fois, dures. Les allemands avaient entouré
et tué une bande de 18 Patriotes, qui habitaient
à 2 miles de nous. Parmi ces morts, il y en avait 4
qui nous avaient apportés des cigarettes. Sept ont
été tué en combattant l’ennemi, et
les onze autres ont été pris par les allemands
et torturé à mort. Il y avait forte
possibilité que les allemands auraient
découvert des informations sur notre existence.
Le lendemain matin le meunier a monté
l’escalier en vitesse, et en criant à haute
voix, ‘Allez, allez – les Boches…’
En moins d’une seconde, nous sommes descendus en
courant, et nous l’avons suivi vers
l’arrière du bâtiment où il nous a
fait signe de nous sauver vers un marais à 300
mètres de là. Les allemands avançaient
sur la route. Nous nous sommes précipités vers
le marais, et nous nous sommes cachés parmi les
joncs, et pendant ce temps, la voiture de
l’armée allemande est arrivée devant le
moulin. Un officier en est sorti.
Très bientôt, nous avons entendu deux
coups de fusil.
Impossible pour nous de savoir ce qui s’est
passé, mais nous avons eu peur pour nos hôtes,
qui ont été peut-être tué. Dans
l’après-midi, la fille du meunier est
arrivée avec un tas de pain, du beurre, et une carafe
de cidre. Elle nous a expliqué que ses parents
n’étaient pas en danger. Un des officiers avait
tiré son fusil, quand un fermier et sa charrette
s’étaient approchés lentement du moulin,
au moment où les allemands avaient voulu partir.
C’était leur façon de dire,
‘Laissez-nous passer ou prenez les
conséquences.’ On s’attendait
quand-même à d’autres fouilles.
Une jeune femme, si belle et si gentille
Cette nuit-là, nous sommes restés dans
le marais, et toute la journée suivante aussi,
jusqu’à minuit quand on nous a dit de retourner
au moulin. Nous avons eu de quoi manger, et nous avons
rencontré notre nouveau guide. C’était
une jeune femme d’environ 19 ans – une fille
blonde et habillée à la mode – je
l’appellerai Paulette. Elle était aussi une des
plus gentilles jeunes femmes que j’ai jamais eu
l’occasion de rencontrer, et elle était Patriote
et responsable pour des missions d’une
difficulté extrême.
Elle nous a expliqué que la tête de pont
en Normandie était à une bonne centaine de
miles de nous, et que ce serait trop dangereux pour nous de
nous y approcher. Cependant une autre solution avait
été organisée, nous a-t-elle
rassuré, en nous souriant, les yeux pétillants
et pleins de vie.
Cette première nuit, nous l’avons suivi
pour 10 miles. Elle est restée avec nous pendant 3
jours et 3 nuits, et elle nous a laissé avec un autre
groupe de Patriotes, avec qui nous avons passé une
semaine.
Après 8 jours, Paulette est revenue pour la
prochaine étape.
Le lendemain, nous sommes partis à pied
à huit heures du matin, et nous avons passé
quatre heures à essayer d’entrer dans une petite
ville sans être aperçus par les patrouilles
allemandes. C’était la ville où habitait
Paulette – et en plus les allemands y maintenaient une
garnison – juste en face de la maison de Paulette.
Finalement nous avons réussi à nous
enfiler inaperçus dans la maison, et nous avons eu
l’occasion de rencontrer sa mère – une
vieille dame impressionnante qui avait perdu quatre fils
pour la France. Le dernier de ses fils était parti en
Angleterre pour rejoindre l’Armée de l’Air
(RAF) ; et maintenant il était porté
disparu. Il ne lui restait plus de fils, et
c’était maintenant à Paulette de
continuer le combat pour la France…..
C’était comme ça dans cette famille.
Nous avons été à peine une heure
dans la maison, quand dehors nous avons entendu des cris et
des coups de fusils dans la rue. C’était une
patrouille allemande qui se comportait comme des cow-boys.
Ils ont démoli la porte d’entrée de la
maison après la maison d’à
côté, et ont forcé les habitants de les
accompagner.
A la fin, nous nous sommes couchés….
Brennan et moi-même dans une chambre, et les 3 autres
dans une autre chambre. Le lendemain, nous avons pu regarder
avec intérêt, les allemands sortir de leur
caserne en face ; de les regarder mettre toutes leurs
possessions dans des charrettes de ferme, avant de partir
pour le front. Il nous semblait qu’il ne restait que de
jeunes garçons et des hommes âgés.
Certains, parmi les jeunes, pleuraient.
Encore 2 nuits, et Paulette nous a informé
qu’il était temps de partir – la
dernière étape - et nous l’avons suivie
en direction de la côte. Sur le chemin, d’un
buisson quelconque, elle a retiré un détecteur
de mines magnétique, avec des écouteurs.
Quelque part, elle avait appris à l’utiliser
– et elle aurait en avoir besoin – parce que nous
sommes entrés dans un champ de mines qui
s’étendait pour une distance de quelques miles.
Paulette avançait pas à petit pas, tout en
faisant des mouvements circulaires, des deux
côtés, avec sa ‘poêle au bout
d’une manche à balai’. Ses gestes avaient
l’air d’une danse complexe. Si elle
repérait une mine, elle laissait tomber un mouchoir
là-dessus. On apercevait simplement la couleur
blanche du mouchoir, comme une fleur de rose dans
l’obscurité de la nuit. Puis elle avancerait en
prenant un tout petit pas circonspect – et le mouchoir
tomberait. Le dernier à suivre devait ramasser les
mouchoirs et les faire passer à l’avant de la
file.
Nous avons continué de cette façon pour
sept miles ; c’était lent, angoissant, et
nous avons avancé pas à pas ; des fois si
près des tranchées allemandes que nous avons
pu entendre parler les soldats ; et il nous a
semblé impossible pour eux de ne pas nous voir
passer. Au mois de juin le soleil se lève tôt,
et pourtant nous n’avons pas pu se presser ou avancer
plus rapidement. C’était comme l’avance
d’un escargot, contre le soleil et la
découverte. Finalement nous sommes sortis du champ et
Paulette nous a fait signe d’avancer à la
prochaine étape. Le censorat m’interdit de vous
décrire cette dernière étape, mais je
peux vous dire, qu’en nous tenant debout là
où elle nous a laissé, et en regardant
Paulette retourner dans le champ de mine mortellement
dangereux, tout en faisant sa petit danse lente comme un
‘adagio’, avec sa manche à balai et le
détecteur de mines, nous avons eu le profond regret
de ne pas pouvoir l’emmener avec nous. Nous avons
prié Dieu ; si sincèrement, nous avons
prié Dieu de la permettre de sortir en toute
sécurité de ce champ de mines.
Déjà beaucoup trop de sang français
héroïque avait été perdu pour
assurer notre évasion. Déjà beaucoup
trop.
Cinq jours plus tard, nous sommes arrivés en
Angleterre.
|